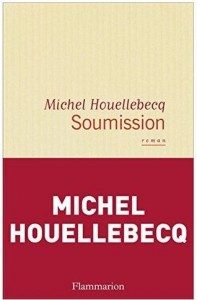 Chaque nouveau roman de Michel Houellebecq crée l’événement avant même sa sortie en librairie. Avec Soumission (Flammarion, 320 pages, 21 €), le plat, une fois encore, nous a été servi sans surprise, juste relevé d’une pointe d’hystérie supplémentaire. Critiques et journalistes, qui avaient reçu à l’avance des jeux d’épreuves, se sont ainsi pressés au portillon médiatique pour prêcher leur « bonne parole », en d’autres termes avertir les lecteurs infantilisés du caractère supposé nocif du volume qu’ils risquaient de tenir entre leurs mains quelques jours plus tard. Méthode contre productive s’il en est : le succès des ventes le prouve, car on ne jette pas le voile sur une publication en tentant de dissuader le public de la lire !
Chaque nouveau roman de Michel Houellebecq crée l’événement avant même sa sortie en librairie. Avec Soumission (Flammarion, 320 pages, 21 €), le plat, une fois encore, nous a été servi sans surprise, juste relevé d’une pointe d’hystérie supplémentaire. Critiques et journalistes, qui avaient reçu à l’avance des jeux d’épreuves, se sont ainsi pressés au portillon médiatique pour prêcher leur « bonne parole », en d’autres termes avertir les lecteurs infantilisés du caractère supposé nocif du volume qu’ils risquaient de tenir entre leurs mains quelques jours plus tard. Méthode contre productive s’il en est : le succès des ventes le prouve, car on ne jette pas le voile sur une publication en tentant de dissuader le public de la lire !
Si les uns y voient un grand livre et d’autres un ouvrage médiocre, beaucoup en redoutent les prétendus effets. A croire que rien n’a vraiment changé depuis le XIXe siècle, où les bien-pensants avançaient, sans rire, que le roman (songeons, entre autres, à Madame Bovary) corrompait les « bonnes mœurs » et faisait naître de coupables pensées dans l’esprit des jeunes et (bien entendu) des femmes…
Balzac et Gautier dans les années 1830, puis Baudelaire et Flaubert dans les années 1850 avaient assez milité en faveur de l’autonomisation de la littérature pour que des critiques, en 2015, ne s’époumonent plus à sacrifier celle-ci sur l’autel d’un très hypothétique désordre social que le roman provoquerait.
Car un roman n’est pas le réel, il ne repose que sur une fiction ; c’est une création de l’esprit, une œuvre d’art, au même titre qu’une peinture ou une sculpture ; c’est donc une invitation à déranger, à réfléchir, à s’interroger et non un vecteur de moralisation des masses. Il ne se confond pas avec un essai ; quel que soit son contenu, sa nature autonome relève de la liberté de création et échappe à tout encadrement éthique externe ; il se juge selon ses propres critères esthétiques (style, forme, etc.), non à l’aune d’un discours normatif ou politiquement correct. Bref, et pour répondre aux parallèles intellectuellement souffreteux qui ont fleuri ici et là, Soumission ne saurait être comparé au Suicide français d’Eric Zemmour.
Cependant, parce que ce conte moderne, qu’on qualifiera de « politique fiction » ou « d’anticipation », puisqu’il est supposé nous transporter en 2022, évoque l’élection à la présidence de la République d’un énarque chef d’un parti musulman et les changements sociétaux qui en découlent, parce que ce sujet transgresse une sorte de nouvel ordre moral, de nombreux chroniqueurs y virent un livre plus ou moins « islamophobe ». Le télescopage de sa sortie en librairie et de l’assassinat des journalistes de Charlie Hebdo sembla plonger ces chroniqueurs dans un état de sidération lié à l’embarrassante question de la liberté d’expression. Ce n’était pourtant pas la première fois qu’un tel carambolage avait lieu : à la publication d’un autre texte de Houellebecq, Plateforme (2001), quelques beaux esprits s’étaient déjà insurgés, notamment contre l’une des scènes finales du livre, qui décrivait un attentat meurtrier mené par un groupe de djihadistes dans un club de vacances thaïlandais. Or, quelques mois plus tard, à Bali, un bar fréquenté par des touristes avait été la cible d’un attentat à la bombe, faisant plus de 200 victimes… La réalité sinistre consacrait le naufrage d’une insubmersible cécité angélique.
Soumission serait donc pour bien des commentateurs un roman « islamophobe », épithète fourre-tout (exploitée à l’origine, non par les Musulmans, mais par les fondamentalistes de l’Islam politique) qui englobe à la fois des attitudes racistes nettement condamnables et un regard critique, légitime dans le cadre d’une pensée laïque, porté sur la religion musulmane. Ce n’est pas un hasard si les intégristes chrétiens, par mimétisme, brandissent l’épouvantail de la « christianophobie » dans des contextes analogues, car c’est bien l’analyse critique que tous les religieux radicaux tentent de faire taire. Les professionnels de l’indignation y sont donc allés de leur diatribe – la leçon de morale littéraire de Christine Angot dans Le Monde ne fut pas la moins singulière ni, compte tenu de son passif judiciaire, la moins incongrue.
Or, sauf à (trop bien) penser que tout regard non-complaisant porté sur un Islam sacralisé en tabou sociétal relèverait de l’islamophobie, on peine à trouver dans le roman de Houellebecq des passages aussi violents contre cette religion que ceux qui figuraient dans Plateforme, voire dans Les Particules élémentaires. Sans doute l’intrigue de Soumission repose-t-elle sur l’élection – démocratique, fondée sur une alliance de partis républicains afin de barrer la route à Marine Le Pen – d’un président islamiste « modéré » issu de la « Fraternité musulmane », laquelle entraîne des changements dans la société, tels que l’introduction de la polygamie, la disparition des femmes du monde professionnel facilitée par une forte augmentation des allocations familiales, la disparition de la jupe au profit du pantalon ou de longs vêtements informes (phénomène largement observé de nos jours dans certains quartiers) ou le retour à la morale traditionnelle (déjà présente dans le discours de la Droite conservatrice depuis quelques années).
Pour autant, force est de constater que, sur le registre de la critique de l’Islam, l’auteur se montre d’une modération inhabituelle. Il aurait pu, à la faveur d’une fiction, mettre en œuvre un dispositif caricatural, outrancier, jouer avec les peurs du public, évoquer, comme tel est le cas dans les théocraties les plus radicales, le port obligatoire du niquab et de la barbe, l’interdiction de la musique, du cinéma, du football, des bars, etc. Or, dans le contexte qu’il choisit, il nous montre une vision plutôt apaisée de l’Islam politique, où les conversions ne semblent pas impliquer la circoncision, où les convertis boivent du Meursault, où l’on sert de l’alcool dans les réceptions officielles auxquelles assistent des bailleurs de fonds saoudiens…
La description de ce monde étrange, inattendu, presque artificiel, à laquelle s’ajoutent de longs développements géopolitiques qui doivent plus à Wikipedia qu’aux travaux d’Antoine Sfeir ou de Gilles Kepel (les belles pages qui évoquent Huysmans sont d’une tout autre nature !), désamorce de facto tout sentiment d’islamophobie.
Ce qui dérange les bien-pensants se situe donc aussi (surtout ?) ailleurs et l’agitation de leurs chiffons rouges masque un autre malaise, peut-être moins avouable. Car, à travers son héros, universitaire spécialiste de Huysmans, désespérément seul, nihiliste, misanthrope, détestablement misogyne, désabusé, dont la vie n’est rythmée que par ses cours, les tracas administratifs, les courses au supermarché du coin et le recours sporadique aux escort girls, c’est le regard porté sur certains aspects de la société contemporaine qui gêne, parce qu’il crée une rupture par rapport au discours convenu.
Ce que l’on reproche à Houllebecq, au fond, c’est d’abord la neutralité hautement subversive avec laquelle il traite son sujet, dans la lignée du réalisme satirique d’un Balzac, d’un Flaubert ou d’un Zola en littérature et d’un Courbet en peinture. C’est ensuite l’humour grinçant dont il a le secret pour construire une fiction bien plus sociologique que politique qui crée le malaise, notamment à travers les portraits très courts, mais au vitriol et hilarants, qu’il brosse des décideurs politiques veules et prêts à tous les compromis opportunistes, des élites médiatiques à l’autisme idéologique sournois. On ne résiste guère aux quelques lignes consacrées à Jean-François Copé, François Bayrou, Stéphane Bern, David Pujadas ou Christophe Barbier. L’auteur ouvre ici les portes d’un cimetière des vanités.
C’est enfin la passivité avec laquelle tout un pays se plie aux réformes sociétales éloignées de sa culture qui trouble dans la mesure où elle traduit au sein de la population une quête diffuse de conservatisme, d’un retour à l’ordre moral patriarcal quel qu’en soit le prix. Le silence des partisans de la laïcité, tétanisés dans leur conformisme vaguement humaniste et politiquement correct, indispose tout autant – la seule résistance, peu crédible, étant dévolue à un mouvement assez ridicule nommé « Les Indigènes européens », plus ou moins peuplé de transfuges des blocs identitaires… Finalement, le plus glaçant, dans ce roman d’anticipation, semble moins l’arrivée à l’Elysée d’une idéologie religieuse que la dissolution de cette laïcité, à bout de souffle faute de volontarisme, présentée comme une parenthèse de l’histoire.
Le récit, habilement construit, même s’il n’atteint pas la puissance d’Extension du domaine de la lutte ou des Particules élémentaires, est celui d’une double décomposition, d’un double naufrage : celui d’une société qui renonce à défendre ses valeurs essentielles issues des Lumières parce qu’elle refuse toute confrontation, toute résistance démocratique et celui d’un héros désabusé, a priori athée, qui finit par se convertir par résignation, opportunisme et recherche d’une zone de confort qu’il n’avait jamais connue auparavant.